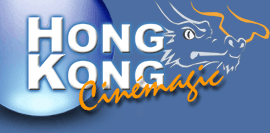|
Downtown Torpedoes (1997) |
 |
 |

 Quatre experts en vol industriel sont recrutés de force par la MI 5 (la CIA Britannique) afin de former la ATM (Advanced Tactical Mercenaries) une équipe chargée de dérober des plaques de fausse monnaie. Mais la mission va mal tourner et les membres de la ATM vont devoir tout mettre en œuvre pour prouver leur innocence et récupérer ses fameuses plaques. Quatre experts en vol industriel sont recrutés de force par la MI 5 (la CIA Britannique) afin de former la ATM (Advanced Tactical Mercenaries) une équipe chargée de dérober des plaques de fausse monnaie. Mais la mission va mal tourner et les membres de la ATM vont devoir tout mettre en œuvre pour prouver leur innocence et récupérer ses fameuses plaques.
 Le triomphe planétaire de l’adaptation cinématographique de la série culte Mission Impossible en 1996 avec Tom Cruise en tête d’affiche n’est clairement pas passé inaperçu à Hong Kong. Toujours prompt à recycler les idées des autres, l’industrie locale ne s’est ainsi pas privée de mettre sur pied une œuvre qui lorgne très fortement du côté du film de Brian De Palma. Le triomphe planétaire de l’adaptation cinématographique de la série culte Mission Impossible en 1996 avec Tom Cruise en tête d’affiche n’est clairement pas passé inaperçu à Hong Kong. Toujours prompt à recycler les idées des autres, l’industrie locale ne s’est ainsi pas privée de mettre sur pied une œuvre qui lorgne très fortement du côté du film de Brian De Palma.
Downtown Torpedoes, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est mis en scène par Teddy Chen, réalisateur aujourd’hui bien connu grâce notamment au succès de sa dernière réalisation « Bodyguards And Assassins » Bien loin du style très pompeux de ce dernier, Teddy Chen livre ici une réalisation tout ce qu’il y a de plus quelconque, sans véritable personnalité. La mis en scène est celle d’un artisan appliqué. Ni plus, ni moins. Le film manque parfois un peu de rythme et semble en permanence en mode pilotage automatique mais bénéficie toutefois de scènes d’actions particulièrement efficaces. Ces dernières ayant été chorégraphiées par Stephen Tung. Beaucoup moins connu qu’un Yuen Woo-Ping ou qu’un Ching Siu-Tung, Stephen Tung n’en reste pas moins un chorégraphe talentueux. Il a d’ailleurs collaboré à plusieurs reprises avec Tsui Hark, pour « The Blade » ou « Seven Swords » notamment. Plus récemment, on lui doit les combats du très réussi « Reign Of Assassins ».
Le casting est essentiellement composé de jeunes stars en devenir. C’est ainsi que les quatre rôles principaux sont interprétés respectivement par Takeshi Kaneshiro (« House Of Flying Daggers »), Jordan Chan (« Young And Dangerous »), Charlie Young (« The Lovers ») et Ken Wong (« Gorgeous ») dont c’est ici le premier rôle au cinéma. Un quatuor jeune donc mais qui fonctionne plutôt bien grâce à des personnages intéressants et plutôt bien écrits malgré un scénario convenu. Seul bémol à mettre à l’actif de Charlie Young qui semble mal à l’aise et, contrairement à ses partenaires masculins, son jeune âge ne lui permet pas d’être crédible. Signalons également la présence du fameux Alex Fong dans le rôle du bad guy de service. Un rôle qui tient presque plus du caméo qu’autre chose tant sa présence à l’écran est pour le moins réduite.
S’il ne fera pas vraiment date dans l’histoire du cinéma d’action hongkongais, Downtown Torpedoes n’en reste pas moins un honnête divertissement. Mis en scène sans génie mais avec efficacité, le film a en plus le mérite de s’éloigner de son modèle américain grâce notamment à un scénario qui met en avant un véritable travail d’équipe et non juste une superstar du box office. Rien que pour ça, il mérite d’être redécouvert.
|
 |
 |
Jean-François Gendron 7/5/2012 - haut |
 |
 |
Teddy Girls (1969) |
 |
 |
 Après une bagarre dans un club, Josephine Siao est envoyée en prison. Mais derrière ces agissements se cachent une personnalité trouble liée à un passé douloureux. Après une bagarre dans un club, Josephine Siao est envoyée en prison. Mais derrière ces agissements se cachent une personnalité trouble liée à un passé douloureux.
 Patrick Lung ne jouit pas encore dans nos contrées de la réputation des grands maîtres du cinéma de Hong Kong. La faute ? Sûrement un désintérêt de la critique française pour le cinéma local avant que la vague kung fu post-Bruce Lee et évidemment les Cahiers du cinéma de 1984 n'ouvrent quelque peu la voie. Mais là où le cinéma japonais (popularisé en occident dès le début des années 50, après Rashômon) a permis aux critiques de redécouvrir la cinématographie nationale, remontant jusqu'à des cinéastes tels que Shozô Makino, Daisuke Itô, voire même beaucoup plus tôt avec Tsunekichi Shibata, toute la cinématographie hongkongaise "pré-Shaw Brothers-couleur-arts-martiaux-King Hu-Chang Cheh" n'a pas encore véritablement trouvé de public (même de niche) et encore moins de diffuseurs. La Cathay ? La Union Film ? La Great Wall ? On attend encore leurs rétrospectives à la cinémathèque (monsieur Rauger, si vous me lisez...). Alors, il est certain qu'une grande partie de la production a disparu, mais il reste toujours des choses à dire sur ces centaines de films restant. Et de ce côté là, le cinéma urbain et le polar des années 60 et 70 reste grandement oublié. Dommage pour Patrick Lung, c'était un des meilleurs artisans du genre. Patrick Lung ne jouit pas encore dans nos contrées de la réputation des grands maîtres du cinéma de Hong Kong. La faute ? Sûrement un désintérêt de la critique française pour le cinéma local avant que la vague kung fu post-Bruce Lee et évidemment les Cahiers du cinéma de 1984 n'ouvrent quelque peu la voie. Mais là où le cinéma japonais (popularisé en occident dès le début des années 50, après Rashômon) a permis aux critiques de redécouvrir la cinématographie nationale, remontant jusqu'à des cinéastes tels que Shozô Makino, Daisuke Itô, voire même beaucoup plus tôt avec Tsunekichi Shibata, toute la cinématographie hongkongaise "pré-Shaw Brothers-couleur-arts-martiaux-King Hu-Chang Cheh" n'a pas encore véritablement trouvé de public (même de niche) et encore moins de diffuseurs. La Cathay ? La Union Film ? La Great Wall ? On attend encore leurs rétrospectives à la cinémathèque (monsieur Rauger, si vous me lisez...). Alors, il est certain qu'une grande partie de la production a disparu, mais il reste toujours des choses à dire sur ces centaines de films restant. Et de ce côté là, le cinéma urbain et le polar des années 60 et 70 reste grandement oublié. Dommage pour Patrick Lung, c'était un des meilleurs artisans du genre.
Teddy Girls commence pourtant fort. Dès les premiers plans, le spectateur est plongé dans les swinging sixties : boule à facette, musique rock, coiffures Vidal Sassoon, tout est là pour nous donner envie de se déhancher. Pour se faire une idée, imaginez l'ambiance pop du Temptress of a Thousand Faces de Jeong Chang-Hwa, mais avec les décors de studio de la Shaw Brothers en moins. Ici, Hong Kong, on vous le montre ! Josephine Siao, tête d'affiche du film, arbore un regard affuté. Enfant à problème, elle exprime par un regard que sous ses allures de fille sage (jolie robe jaune pastel, queue de cheval bien nouée) elle est aussi enragée que la Meiko Kaji des Stray Cat Rock. Il ne suffit que d'une étincelle, un soir, un homme venant peloter son amie dans un nightclub, pour que la féline explose et fasse jaillir la rage qu'elle renferme. A comportement violent, environnement adapté : la voilà envoyée en centre de correction pour jeunes délinquants. A partir de là, nous voilà dans un gentil "women in prison" (tiens tiens! Dire que Stray Cat Rock: Sex Hunter date de 1970 et La femme scorpion de 1972. Je dis ça, je ne dis rien!) où la jeune fille se fait dans un premier temps accueillir avec tous les honneurs du nouveau venu (on est cependant encore loin des touches sadiques du film de David Lam). Elle devient donc la cible de Nancy Sit. Mais attention, en 1969, la victimisation ne vas pas plus loin que de se faire coller un papier dans le dos et jeter du riz au visage (bon, et peut-être se fait-elle tabasser une ou deux fois).
Par la suite, tout devient plus relax, des amitiés se forgent (notons la présence de la réservée, mais un peu peau de vache quand même, Lydia Shum). Le film fait presque penser à du Inspector Wears Skirts. Pour preuve, les recrues... pardon, les pensionnaires font un défilé de mode printemps/été 69. Tout ça, probablement parce que Kenneth Tsang, ici directeur de la prison, a toujours été un mec sympa. Heureusement, il reste quand même une enflure dans cette histoire: Lung Kong himself ! Cela tombe bien, puisque grâce à lui, le dernier acte du film sera une vraie tragédie. Pendant que le père de Josephine Siao se meurt sur son lit de mort (c'est le lit tout indiqué pour mourir, pas moyen de se tromper), sa chère épouse se trouve dans le lit conjugal avec Patrick Lung (on ne meurt pas là où l'on dort, ça devrait se savoir!). Plus loin dans le film, c'est au tour de la veuve de se donner la mort. Pas de doute, pour Josephine (c'est aussi le prénom de l'héroïne du film), c'est ce vieux loup de Lung Kong qui la lui a donné. A partir de là, évasion, vengeance et tout le toutime. Au milieu de tout cela, le réalisateur et scénariste glisse une réflexion, discrète certes, mais présente. Questionnant le système, Patrick Lung interroge la pertinence des centres correctionnels pour délinquants juvéniles mais également les inégalités devant la loi mais surtout la pression exercée par l'environnement social. Tout cela s'achève par un regard entre stupéfaction et perplexité, constatant l'impuissance de la société à remédier à ses propres maux. Cela n'évite cependant pas quelques facilités dont un monologue très didactique de Kenneth Tsang évoquant les conséquences de la société industrielle.
Évidemment, ce qui interpelle dans ce film, c'est sa maitrise formelle. Et à ce jeu là, il est nécessaire d'évoquer le monteur, un certain Yeung Pak-Wing, qui, peut-être sous l'impulsion de Patrick Lung (historiens du cinéma, voilà une enquête à mener!), maîtrise l'art du montage cut et de la répétition. Les scènes d'euphorie sont proprement incroyables pour l'époque. La danse comme la violence. Lors de certaines scènes de combat, on pense parfois à la crudité jazzy de Kinji Fukasaku. Hélas, tout n'est pas toujours maîtrisé et certains affrontements relèvent plus du tirage de maillots et des éclaboussures que de la brutalité. Mais le film ne se distingue pas que par son hystérie. Dans l'ensemble, c'est même un film très intériorisé, qui se contient avant d'exploser. Pour donner corps à ces pulsions latentes, Patrick Lung démontre une réelle maîtrise de la mise en scène. Certains plans sont proprement hallucinants. Pour introduire un flashback, le réalisateur choisit de plonger Josephine dans ses souvenirs. Pour cela, elle fixe la télévision où deux amants s'embrassent. La caméra traverse alors l'écran de télé (un cadre se tenant entre la caméra et le plateau) pour nous faire plonger avec Joséphine dans ses traumas. Un choix de mise en scène audacieux (ou dépassé, pour certains abreuvés aux CGI), mais qui synthétise totalement la psychologie du personnage.
Teddy Girls est une œuvre importante. Des films de jeunes délinquants, il y en a eu une pelleté à l'époque, à Hong Kong (The Delinquent de Chang Cheh et Kuei Chih Hung) comme au Japon (Crazed Fruit, qui déjà surfait sur la mode des films de jeunes rebelles américains) et celui-ci fait partie des pépites quelque peu oubliées. Il serait donc bien dommage de passer à côté d'un des meilleurs films du réalisateur de Story of a Discharged Prisoner.
|
 |
 |
Anel Dragic 6/27/2012 - haut |
 |
 |
Casino Raiders 2 (1991) |
 |
 |

 Lorsque son maître se fait tuer, Andy Lau décide de le venger. Des bas fonds de Hong Kong jusqu'au tables de jeu, il s'associera à Dave Wong pour mettre fin aux agissements de ses adversaires. Lorsque son maître se fait tuer, Andy Lau décide de le venger. Des bas fonds de Hong Kong jusqu'au tables de jeu, il s'associera à Dave Wong pour mettre fin aux agissements de ses adversaires.
 Replonger le spectateur dans le "ciné HK" de 1991 est une expérience nostalgique, une madeleine de Proust qui le propulse à une époque où les acteurs, les technologies cinématographiques et les manières de filmer étaient bien différentes. Qui pourrait croire un seul instant qu'un film comme Casino Raiders 2, s'il était fait aujourd'hui, puisse être pris au sérieux ? Et pourtant, c'est bien de cette manière que le spectateur nostalgique voit et aime ces films. Deux ans après un premier opus plus ou moins sympathique, mais totalement oubliable, Johnnie To donne une suite à Casino Raiders. Une suite ? Façon de parler puisqu'à part le titre, le milieu du jeu et Andy Lau, il n'y a pas de véritable rapport entre les deux opus. Le cadre y est complètement différent, les personnages aussi, et Andy tient également un autre rôle que celui du premier, ce qui est logique puisque son personnage y mourrait. Replonger le spectateur dans le "ciné HK" de 1991 est une expérience nostalgique, une madeleine de Proust qui le propulse à une époque où les acteurs, les technologies cinématographiques et les manières de filmer étaient bien différentes. Qui pourrait croire un seul instant qu'un film comme Casino Raiders 2, s'il était fait aujourd'hui, puisse être pris au sérieux ? Et pourtant, c'est bien de cette manière que le spectateur nostalgique voit et aime ces films. Deux ans après un premier opus plus ou moins sympathique, mais totalement oubliable, Johnnie To donne une suite à Casino Raiders. Une suite ? Façon de parler puisqu'à part le titre, le milieu du jeu et Andy Lau, il n'y a pas de véritable rapport entre les deux opus. Le cadre y est complètement différent, les personnages aussi, et Andy tient également un autre rôle que celui du premier, ce qui est logique puisque son personnage y mourrait.
Après avoir enchainé les comédies et petits drames, Casino Raiders 2 marque une date dans la filmographie de Johnnie To, puisqu'il signe là son premier vrai film d'action (peut-on vraiment lui attribuer la paternité de The Big Heat ?) mais également sa première collaboration avec Andy Lau. Casino Raiders 2 s'éloigne de son modèle, et ce sous plusieurs aspects. Outre le fait qu'il s'agit d'une fausse suite plaçant le spectateur dans un cadre différent, cet opus fait le grand écart avec le premier volet tant en ce qui est de l'atmosphère que la tonalité de l'ensemble. Wong Jing et Jimmy Heung livraient déjà une œuvre tragique, mais beaucoup plus crue, alors que Johnnie To adopte une approche résolument plus dramatique. Dans la lignée d'A Moment of Romance que Benny Chan réalisa en 1990, Johnnie To choisit de faire de son film un pur mélodrame. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère le bougre ! Casino Raiders 2 aurait tout aussi bien put s'appeler "One Hundred Moment of Romance" tant les scènes larmoyantes s'enchainent les unes derrière les autres. Si vous ne souhaitez pas en savoir plus sur l'intrigue, je ne peux que vous conseiller d'abandonner la lecture de l'article à la fin de cette phrase, maintenant si cela ne vous dérange pas (car après tout l'intrigue de la grande majorité des séries B HK importe peu) abordons tout ce qui fait le sel de cette séquelle (qu'il ne faut pas confondre avec No Risk, No Gain - Casino Raiders the Sequel).
Pour l'histoire, Andy est le disciple de Lau Siu Ming. Un jour, le vieil homme se fait tuer par une bande de triades; raison suffisante pour que le jeune homme décide de venger son maître... par les cartes ! Parallèlement, Dave Wong tente de récupérer sa fille et d'échapper à ses problèmes avec les triades. Les deux amis vont alors s'associer pour mettre fin aux agissements de leurs ennemis. Comme il a été dit plus haut, Casino Raiders 2 est en tout point plus romantique que l'original. Le film est fortement inspiré par A Moment of Romance, et il semble peu probable que le choix d'Andy Lau et Jacqueline Wu Chien Lien au casting, duo star du film de Benny Chan, soit une coïncidence. Casino Raiders 2 est le genre de film que l'on ne regarde pas pour son intrigue (prétexte), mais davantage pour chaque scène individuellement. Le film est parsemé de passages versant dans l'excès larmoyant et la surenchère dramatique. On sait les cinéastes hongkongais un peu sadiques, et les voir infliger autant de cruauté à leurs personnages prête tout autant à pleurer qu'à sourire. Il suffit de voir la fille de Dave Wong, élevée comme un animal par des "tuteurs" peu scrupuleux. On a alors un peu de peine pour la petite Chan Cheuk Yan qui prend décidément cher à chacun de ses rôles (c'était la gamine trainée par les cheveux lors d'une poursuite en bagnoles dans Fatal Termination). Ici, la petite est battue et attachée à un poteau comme n'importe quel chien. Difficile de rester sérieux face à la situation et au mélo kitsch de la réalisation de Johnnie. Devant un tel déchainement de violence, on peut se poser la question de savoir quelle approche adoptera Johnnie To. Le réalisateur dépeint ici une violence plutôt crue de la manière la plus romantique qui soit, amplifiée par les chorégraphies brutales de Tony Ching Siu Tung, aux antipodes du style drapé aérien que l'on aime lui attribuer. To parvient également à instaurer une atmosphère et une tension à l'ensemble, grâce à un montage et un usage de la musique très efficace.
Car c'est à la fois la grande force du film, mais également ce qui fait qu'un spectateur d'aujourd'hui aurait beaucoup de mal à entrer dans le "trip". Et pourtant, même pour l'amateur de cinéma de Hong Kong des années 90, il est bien difficile de rester de marbre devant tant d'élan romantique sur fond de cantopop : tristesse, violence, déchirement,... autant d'évènements exacerbés par la musique. Le film ne se contente pas d'être excessif uniquement dans sa mise en scène. Le scénario n'est pas en reste et se prête également à transcender l'ensemble. Comment garder tout son sérieux lorsque l'on voit Andy Lau perdre au jeu, sortir du bar en slip sur le ton le plus dramatique qui soit, tout cela sans une once de second degré ? Comment ne pas prendre un plaisir coupable lorsqu'on le voit tenter de réanimer sa fiancée qui venait de se faire noyer de manière barbare, le tout au ralenti avec des explosions en arrière plan ? Ou encore : Comment ne pas adorer le cinéma de Hong Kong de l'époque quand on y voit Dave Wong se couper la main pour récupérer sa fille ? C'est pourtant pour tous ces aspects que l'on adorera le film, plus que pour n'importe quelle autre raison "valable" pour un cinéphile moins averti.
Comme il a été dit plus haut, cette suite est très différente du premier opus. Tout d'abord parce que le scénario de Tsang Kan Cheung (Royal Warriors, My Heart Is That Eternal Rose) s'intéresse moins aux scènes de gambling qu'à la dramaturgie. Même ce qui est annoncé dans l'introduction comme la base de l'intrigue (une sombre histoire d'artefact ayant appartenu au dieu du jeu) est vite relégué au second plan, laissant une plus grande place aux personnages et à leurs soucis respectifs. Car il s'agit avant tout d'un film de personnages, exploitant au maximum la présence de son excellent casting. Andy Lau y est plus "stylish" que dans le premier opus, bien qu'il ait un rôle moins important. A côté de ça Anthony Wong est au sommet de sa laideur, affublé d'une moustache et d'une queue de cheval le faisant ressembler à Danny Trejo. Tous les personnages sont réunis pour s'entrechoquer lors d'affrontements "physiques" ou cartes sur table. Et bien que le gambling soit moins présent, le film offre malgré tout un final assez réussi, bien qu'en dessous du premier volet.
Casino Raiders 2 est un excellent divertissement qui demandera toute l'affection du spectateur pour remporter son adhésion. Plutôt que d'essayer d'entrer dedans par un jugement des qualités artistiques (bonnes ou mauvaises, peu importe), essayez plutôt de vous faire prendre par les sentiments, et peut-être découvrirez vous qu'il y a au fond un grand romantique qui ne demande qu'à verser sa larmichette devant quelques scènes dramatiques bercées par de la cantopop des années 90.
|
 |
 |
Anel Dragic 1/17/2012 - haut |
 |
 |
Don't Go Breaking My Heart (2011) |
 |
 |

 Zixin (Gao Yuan Yuan) vient de rompre avec son petit ami. Shen-ran (Louis Koo), qui est attiré par la jeune femme, assiste à la rupture et décide alors de la séduire. Suite à un rendez-vous manqué, cette dernière fait la connaissance de Fang (Daniel Wu) qu'elle commence à apprécier. Qui de Shen-ran ou Fang réussira finalement à séduire la jeune femme ? Zixin (Gao Yuan Yuan) vient de rompre avec son petit ami. Shen-ran (Louis Koo), qui est attiré par la jeune femme, assiste à la rupture et décide alors de la séduire. Suite à un rendez-vous manqué, cette dernière fait la connaissance de Fang (Daniel Wu) qu'elle commence à apprécier. Qui de Shen-ran ou Fang réussira finalement à séduire la jeune femme ?
 C'est qu'elle semble loin l'époque où Johnnie To commençait à percer dans l'hexagone, où le public français découvrait, la bave aux lèvres, les gunfights statiques de The Mission, où Charles Heung produisait par camions via sa société One Hundred Years of Film. Depuis, To s'est embourgeoisé, sa cadence de réalisation est beaucoup plus espacée, et chacun de ses films suscite désormais des réactions opposées. Pour certains, ses différents projets sont attendus avec une certaine ferveur, tandis que pour d'autres, les productions à venir du réalisateur ne suscitent plus que l'indifférence. Qu'est-il donc arrivé à l'enfant prodige du polar hongkongais pour qu'il ne parvienne finalement plus vraiment à faire consensus même au sein des sphères amatrices ? Pourquoi ses dernières productions interpellent à peine les amateurs de cinéma de Hong Kong ? Deux années se sont écoulées depuis Vengeance, dont la réception critique a divisé l'opinion, les uns n'y voyant au mieux qu'un best of de ses précédents films, en nettement moins réussi, d'autres considérant le métrage comme un étron véhiculant un Johnny Halliday totalement à côté de la plaque. Depuis, Johnnie To s’était en quelque sorte reposé sur ses lauriers, préférant courir les festivals plutôt que d’offrir à sa carrière un nouveau souffle. Et mine de rien, en deux ans, il s'en est passé des choses. Les amateurs d'action se sont tournés vers un Donnie Yen dont la carrière est à son sommet, tandis que les puristes du polar ont accueilli à bras ouvert le style plus brutal de Dante Lam, alignant coup sur coup Stool Pigeon, Fire of Conscience et The Viral Factor. Deux années d'attente au cours desquelles on a eu tout le temps de se lasser de Death of a Hostage, devenu entre temps le Life Without Principle que l'on connaît aujourd'hui, tandis que le projet initial évolua vers ce qui donna Punished de Law Wing Cheong. C'est qu'elle semble loin l'époque où Johnnie To commençait à percer dans l'hexagone, où le public français découvrait, la bave aux lèvres, les gunfights statiques de The Mission, où Charles Heung produisait par camions via sa société One Hundred Years of Film. Depuis, To s'est embourgeoisé, sa cadence de réalisation est beaucoup plus espacée, et chacun de ses films suscite désormais des réactions opposées. Pour certains, ses différents projets sont attendus avec une certaine ferveur, tandis que pour d'autres, les productions à venir du réalisateur ne suscitent plus que l'indifférence. Qu'est-il donc arrivé à l'enfant prodige du polar hongkongais pour qu'il ne parvienne finalement plus vraiment à faire consensus même au sein des sphères amatrices ? Pourquoi ses dernières productions interpellent à peine les amateurs de cinéma de Hong Kong ? Deux années se sont écoulées depuis Vengeance, dont la réception critique a divisé l'opinion, les uns n'y voyant au mieux qu'un best of de ses précédents films, en nettement moins réussi, d'autres considérant le métrage comme un étron véhiculant un Johnny Halliday totalement à côté de la plaque. Depuis, Johnnie To s’était en quelque sorte reposé sur ses lauriers, préférant courir les festivals plutôt que d’offrir à sa carrière un nouveau souffle. Et mine de rien, en deux ans, il s'en est passé des choses. Les amateurs d'action se sont tournés vers un Donnie Yen dont la carrière est à son sommet, tandis que les puristes du polar ont accueilli à bras ouvert le style plus brutal de Dante Lam, alignant coup sur coup Stool Pigeon, Fire of Conscience et The Viral Factor. Deux années d'attente au cours desquelles on a eu tout le temps de se lasser de Death of a Hostage, devenu entre temps le Life Without Principle que l'on connaît aujourd'hui, tandis que le projet initial évolua vers ce qui donna Punished de Law Wing Cheong.
Après une telle attente, c'est finalement avec une romance que Johnnie To nous revient. Ce n'est pas forcément ce qui plaira aux fans d'action, mais le besoin de renflouer les caisses de la Milkyway Image se faisait probablement sentir. Et le spectateur averti ne sait que trop que les romances de Johnnie sont affaire de roulette russe. La probabilité de tomber sur un produit potable équivaut à peu près à jouer avec un six coups dont on aurait retiré une balle (deux si l'on est amateur du genre). Au mieux, vous tombez sur Where a Good Man Goes, avec Yesterday Once More ce sera un mauvais moment à passer, mais rien de fatal, par contre si vous êtes malchanceux, vous vous mangez Needing You, Love For All Seasons, Turn Left Turn Right, ou pire Love on a Diet, en pleine poire. Et cela pour ne parler que des Milky Way, sinon vous pouvez jouer les suicidaires et ajouter A Moment of Romance III dans votre barillet. Épaulé de son indéfectible partenaire Wai Ka Fai, définitivement sur la pente glissante (Fantasia, Himalaya Singh, Written By... Poubelle ! A se demander si Too Many Ways To Be No. 1 n'était pas un incident de parcours), Johnnie To réalise ici une romance plutôt dramatique sur fond de crise économique.
Zixin (Gao Yuan Yuan) est une jeune employée comme tant d'autres travaillant au sein d'une compagnie. Elle se rend au bureau en bus, fait son travail correctement (ce que l'on ne la voit pas tant faire au cours du film finalement), et vient justement de rompre avec Owen (Terence Yin), qui s'avère être un homme marié. Femme enfant, originaire du continent, elle se caractérise surtout par sa difficulté à faire confiance aux hommes, et sa rencontre avec Shen-ran (Louis Koo) ne va pas arranger les choses. Ce dernier est un gérant de compagnie financière, il se rend au bureau en coupé Mercedes, cheveux au vent, mèche imperturbable. Requin charismatique, l'homme ne résiste toutefois pas aux charmes des jolies demoiselles qui croisent son chemin. Malgré son côté salaud, le personnage dégage une certaine sincérité (éternel combat intérieur faisant s'affronter la part négative à la vertu). Après un rendez-vous manqué avec ce dernier, Zixin fait la connaissance de Fang (Daniel Wu), architecte alcoolique mais attachant qui n'a même plus envie de se raser, ni de se laver les joues. Tout le reste repose sur le triangle amoureux formé par ces personnages, chacun étant confronté face à ses propres doutes et faiblesses. Qui choisira Zixin ? Je vous laisse la surprise. Écrit à huit mains (Wai Ka Fai, Yau Nai Hoi, Ray Chan, Jevons Au), le scénario a la bonne idée de laisser ses personnages évoluer sur plusieurs années, permettant ascensions ou déchéances sociales et favorisant l'évolution des personnages. Toutefois, le script se perd souvent dans sa gestion du rythme, ne parvenant pas à retranscrire cette idée d'écoulement du temps, réussissant plutôt à perdre le spectateur dans les incessants allers-retours des personnages (une scène nous présente deux personnages à Hong Kong, la suivante se situe à Suzhou sans que l'on sache qu'il y a eu voyage entre temps). Le va et vient des possibilités de couples tous aussi interchangeables, les différentes situations visant à rendre A jaloux de B en allant avec C, puis même situation dans la scène suivante, changez juste l'ordre des lettres, parfois ajoutez B qui se met à fréquenter D et vous avez une idées des enjeux du film sur la longueur. S'installe dès lors une certaine monotonie rattrapée par une mise en scène astucieuse.
Johnnie To s'amuse avec ses personnages, avec l'espace, et la manière de les placer dans l'environnement afin de créer des jeux scénographiques. Sans faire de l'action, ni même de la ballade poétique en vélo façon Sparrow, le réalisateur parvient à utiliser l'espace de manière habile. Zixin et Fang travaillent chacun dans deux immeubles se faisant face, deux open space donnant à voir l'un sur l'autre. Cette séparation vitreuse, laisse au réalisateur le soin de jouer avec les post-it et les gestes, ou encore l'usage particulier du téléphone pour faire communiquer les personnages. Dommage cependant que ces scènes plus légères semblent la plupart du temps combler un script qui ne sait trop où aller handicapé par un rythme boiteux. Voir Daniel Wu faire des tours de magie et autres numéros de ventriloquie laisse finalement assez indifférent, et le manque d'investissement émotionnel se fait ressentir. La teneur dramatique se résume tout au plus au crapaud de compagnie de Zixin, écrasé par l'homme qu'elle aime, le tout porté par la musique de Xavier Jamaux, tantôt sautillant, ou bien mélancolique (avec du piano donc!). Tout cela est en revanche quelque peu rattrapé par une mise en scène assez réussie qui parvient à instaurer un léger sentiment de malaise social.
Car ce qui se joue en filigrane, et qui nous interpellera d'autant plus, c'est la manière dont le film traite de la crise financière pour dépeindre une Chine en transformation. Les temps ont bien changé depuis The Yuppie Fantasia et les salary-men ne sont plus ce qu'ils étaient. Si l'avenir économique était fleurissant et gentillet chez Gordon Chan, ici la réalité économique, bien que gardant un certain glamour, est bien plus lucide des transformations sociales. La génération qui a grandit avec l'image de Mark Gor brûlant un faux billet de cent dollars est aujourd'hui au cœur d'un capitalisme sauvage, d'une compétitivité exacerbée et animée par une envie de flamber qui n'a plus le temps de s'encombrer des traditions. La ville n'en est que plus terrifiante. Hong Kong et la Chine continentale sont totalement transformés par la caméra de Johnnie To qui choisit de ne montrer que des villes passées dans la modernité la plus froide. Plus aucune trace de tradition, plus aucun plan pour présenter les ruelles vivantes de Kowloon, les néons colorés de Nathan Road. Quelle identité reste-t-il de Hong Kong ? To avait déjà entrepris avec Sparrow de sonder les transformations de sa ville. Il tournait dans les rares vieux quartiers de Central qui restaient de l'ère coloniale. Le film nous montrait un Hong Kong en disparition. Ici, le réalisateur nous montre l'avenir, une société aseptisée, modernisée, privée de tout sentiment de vie. De Causeway Bay à Central, les décors ne sont que tours de verre et de métal. Cheng Siu Keung, fidèle directeur photo de To réussit à capturer cet esprit totalement inanimé de la ville, vidée et plongée dans une modernité mortifère. Tout est propre, comme sorti d'un catalogue. Même les scènes au restaurant, au milieu d'une bourgeoisie se calquant sur le modèle occidental révèlent une fausseté liée à l'imitation du modèle capitaliste. Alors que les sociétés de Hong Kong subissent la crise, la Chine continentale véhicule un modèle économique en floraison et qui permet au personnage de Fang de concrétiser des projets démesurés.
Plus que jamais, Johnnie To s'est ouvert sur le marché de la Chine continentale. Alors que le réalisateur était jusqu'ici l'un des derniers à clamer fièrement faire du cinéma de Hong Kong, il livre ici une œuvre ouverte sur la Chine. Le choix de Gao Yuan Yuan au centre de l'histoire déjà, l'usage conséquent du mandarin tout au long du film, mais aussi les différents voyages en Chine pop. Traitant des nouveaux riches de la Chine populaire, intégrant progressivement la société hongkongaise, Johnnie To s'intéresse à cette nouvelle population, dépeignant au passage de belles demeures dans la région de Suzhou. Le choix de la romance s'impose dès lors, comme pour affirmer une envie de toucher un public plus large, tout en ne froissant pas trop le spectateur. Et au final, on ne s'étonne peu de constater que le cinéma du réalisateur s'est lui aussi embourgeoisé, le vidant de sa substance qui s'ancre dans les rues vivantes de Hong Kong, de ses personnages forts, préférant l'argent à la tradition. Doit-on dès lors encore attendre un retour en force du polar à l'ancienne ? Le doute s'empare de moi.
|
 |
 |
Anel Dragic 12/29/2011 - haut |
 |
 |
Wu Xia (2011) |
 |
 |

 Deux bandits s'attaquent à une fabrique de papier et se font tuer dans l'altercation qui s'ensuit. Un policier est dépêché sur place pour mener l'enquête. Cet événement attire l'attention d'autres bandits sur le village et sur un habitant en particulier. Deux bandits s'attaquent à une fabrique de papier et se font tuer dans l'altercation qui s'ensuit. Un policier est dépêché sur place pour mener l'enquête. Cet événement attire l'attention d'autres bandits sur le village et sur un habitant en particulier.
 Wu Xia, le titre qui devait donner une indication sans trop en dire mais sans mentir non plus Wu Xia, le titre qui devait donner une indication sans trop en dire mais sans mentir non plus
Le cinéma est un art particulier. La littérature invite à un travail d’imagination, la bande dessinée s’appuie sur le langage visuel, et la musique exploite notre ouïe. Mais le cinéma transcende tous ces éléments. On doit à la fois regarder et écouter, et si le travail d’imagination n’est pas le même que devant un livre, le cerveau doit réceptionner et classer toutes ces informations pour émettre un jugement. Ai-je aimé ? Pour quelles raisons ? Quels éléments m’ont moins plu ? L’art est toujours une expérience, tant pour celui qui crée que pour celui qui découvre, mais dans le contexte d’un film, il s’agit d’un voyage dans lequel on nous immerge pendant plus d’une heure. Avec l’avènement de la 3D et de l’Imax, il est évident que la volonté des cinéastes et de faire vivre aux spectateurs une histoire, de leur faire ressentir le frisson de l’aventure et l’émerveillement d’un monde fictif, destiné à être crédible.
Ainsi lorsqu’on tente de disséquer une œuvre, il est indispensable de parler des aspects techniques, de la réalisation, de la direction d’acteurs, des interprètes, de la musique, ou encore de la qualité de l’écriture. Mais il y a un autre élément dont on parle généralement moins : le titre. Il s’agit pourtant bien souvent de la première information qui nous est donnée, souvent avant même que le synopsis ne soit révélé. Et à quelques exceptions prêt, un titre est révélateur du contenu de l’intrigue. Qu’il soit poétique ou littéral, le titre est là pour permettre au spectateur potentiel de comprendre s’il est la cible du film ou non. Avec A Better Tomorrow, le spectateur hongkongais savait par exemple qu’il serait question d’événements difficiles à surmonter avec l’espoir d’une rédemption. En regardant The Killer, le spectateur savait qu’il assisterait aux exploits d’un tueur à gages.
Avec un titre comme Wu Xia, on peut imaginer que Peter Chan Ho Sun va nous raconter les exploits d’épéistes ou de chevaliers errants. D’autant plus lorsque l’on s’intéresse à la genèse de son œuvre. C’est l’envie de réaliser un remake du One Armed Swordswoman de Chang Cheh qui a donné à Peter Chan et Teddy Chen l’idée de s’associer. Après une dispute entre les deux hommes, Celestial Pictures a décidé de laisser les droits d’adaptation à Teddy Chen, dont on attend encore le remake. Peter Chan n’a pas renoncé à rendre lui aussi hommage à ce classique, mais il lui a été nécessaire de modifier son récit et rendre les références plus subtiles. En l’occurrence, le titre ne pouvait plus être identifiable, et on peut se demander si le choix du titre Wu Xia est une façon d’exprimer son amour à un genre qui lui est cher, et qui a vu Jimmy Wang Yu exploser devant la caméra de l’Ogre de Hong Kong. Ce titre est donc un élément à part entière du film, il a lui aussi une histoire, et mérite donc qu'on s'y attarde.
L’influence des aînés
Il ne faut pourtant pas s’attendre à une réelle adaptation des exploits du sabreur manchot. L’intrigue n’a en effet pas grand-chose en commun avec celle du film qui a fait de Jimmy Wang Yu une star. Pourtant, les éléments de comparaison sont nombreux. La présence au générique de deux anciennes gloires de la Shaw Brothers constitue ainsi une belle surprise. Kara Hui ne fait pas beaucoup plus que de la figuration, mais elle s’investit beaucoup dans son rôle, et on constate que malgré son âge, elle se meut toujours avec beaucoup de grâce. Toutefois, c’est la présence de Jimmy Wang Yu qui intrigue davantage, en particulier lorsqu’on sait qu’il interprète l’antagoniste de Donnie Yen. Pendant le tournage, l’acteur avait insisté sur sa volonté d’utiliser le moins de doublures possibles, car pour fêter son retour sur les écrans, il voulait se montrer à la hauteur des attentes du public.
Et s’il a su toucher le cœur des hongkongais en épéiste manchot au grand cœur, sa prestation de chef de clan brutal et colérique a toutes les chances de réjouir les fans. Sa présence y est surprenante, il devient véritablement ce seigneur de guerre qui n'accepte pas qu'on lui désobéisse, et s'impose comme le symbole d'un système trop obsolète car trop rigide. Outre son physique bien exploité, c’est sa voix et sa façon de l’utiliser qui lui confèrent une intensité très forte. Permettre à un acteur qu’on apprécie de trouver un rôle à sa mesure constitue en soi un très bel hommage. Permettre au public de redécouvrir une ancienne gloire, et d’être une fois encore, ébloui par son jeu est une preuve de respect pour les spectateurs. Au-delà des aspirations de Peter Chan en tant que réalisateur, il est donc évident qu’il souhaite sincèrement exprimer son amour des Wu Xia Pian des années 60 et 70, et partager cette passion avec le public d’aujourd’hui.
Ces parti pris semblent également symboliser la recherche de rédemption d’une artiste qui a certainement peur de décevoir en mélangeant ses influences à ses propres idées qui s’éloignent des archétypes du genre. Cette idée est d’ailleurs très forte dans le récit, comme dans beaucoup de films de sabres, mais son impact est décuplé par cette sensation que Peter Chan a besoin de l’assentiment du public pour ne pas être aliéné par des règles qu’on considère peut-être comme trop rigides. Car tout en choisissant un titre qui évoque les arts martiaux et en exploitant les scènes de combat comme élément narratif, le réalisateur est manifestement plus intéressé par ce mélange d’influences, mais aussi par la rencontre entre l’ancienneté et la modernité. Ce traitement est représenté de façon intéressante par le décor de l’action. En effet, le village de paysans rappelle immanquablement le début de Return Of The One-Armed Swordsman où l’on voyait le manchot interprété par Jimmy Wang Yu vivre loin de tout pour échapper au monde des arts martiaux et vivre de la culture de la terre.
Un contraste avec la modernité
Cette vie de labeur va nous être montrée avec un souci d’authenticité appréciable. Les décors et les costumes sont à ce titre très beaux. Trop beaux même. A tel point qu’on a l’impression que les paysans portent des vêtements neufs et ne transpirent jamais. Le premier contraste entre l’ancien et le moderne est donc involontaire et regrettable. Malgré la présence de mouches, et la représentation crédible de la difficulté du travail, la qualité des vêtements, et l’éclat de leurs couleurs diminuent l’immersion. Donnie Yen, en paysan forcé de se battre pour sauver des innocents, fait lui aussi très propre sur lui, mais dans son cas, cela renforce la sensation qu'il cache un passé trouble. Globalement, ces décors et costumes trop réussis sont un peu regrettables car la photographie, très réussie et esthétique rend les paysages magnifiques sans qu’on ait l’impression qu'ils soient irréels. Qu’il s’agisse des maisons, des champs, ou de la forêt, chaque décor dispose d’une véritable identité et d’une ambiance qui s’accorde avec le récit. Visuellement, l’ensemble est très joli, ce qui permet d’apprécier davantage le rythme plutôt contemplatif.
Peter Chan semble d’ailleurs avoir trouvé un équilibre entre la recherche esthétique pure et l’efficacité nécessaire pour mettre en valeur la qualité des chorégraphies. Les combats sont peu nombreux, mais filmés avec beaucoup de rigueur. La caméra reste constamment mobile, et multiplie les plongées, tout en s’assurant que les mouvements sont lisibles. On est bien loin du découpage frénétique et peut maîtrisé de The Warlords. Pourtant, derrière cette réalisation réussie, on sent que les combats n’intéressent pas le réalisateur. Pas en tant que pur spectacle martial. C’est véritablement l’apport du duel dans le contexte de l’intrigue, ou dans la thématique qui pousse Peter Chan à mettre en scène les échanges martiaux.
Il y a bien sûr le premier affrontement, celui qui justifie l’intrigue, et qui vient nous rappeler que les Wu Xia Pian chinois ne sont pas la seule inspiration. [Spoiler] Comment, en effet, ne pas penser à A History Of Violence de David Cronenberg lorsqu’on voit ce paysan sans histoires s’interposer lors d’un vol à l’étalage, ouvrant la voie à un cycle de violence qu’il ne peut pas contrôler ? Et comme dans cette œuvre, il devient rapidement évident que ce qui nous été montré au départ n’est peut être pas conforme à la réalité [/Spoiler] . Mais, une fois de plus, on retrouve également une influence plus ancienne, et plus chinoise, puisque le récit ressemble beaucoup au Avenging Eagle de Sun Chung.
C’est lors de la fameuse scène de la reconstitution du combat que l’on comprend réellement les intentions du réalisateur. Dès la promotion de Wu Xia, on a pu voir des extraits de ce passage et en entendre le plus grand bien. Il est facile de comprendre pourquoi. La façon dont le policier étudie les indices crée un véritable décalage avec la vie hors du temps de ce village. La modernité de ses méthodes d’investigation fait de lui plus qu’un simple étranger : ce sont deux mondes qui s’affrontent. Sa façon d’identifier les indices et d’interpréter les mouvements de Liu Jinxi (Donnie Yen) démontre sa connaissance des arts martiaux, ses capacités d’investigateur, mais aussi sa concentration extrême. En opposition, le témoignage des victimes illustre la découverte d’un univers violent qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer et leur façon simple et sincère de se fier aux gens.
Car tout en se présentant comme victime d’une trop grande empathie, le policier nous explique en voix off qu’il utilise l’acupuncture pour ne plus se laisser envahir par ses sentiments. Ainsi, lorsqu’on le voit en action, il étudie les faits avec une rigueur scientifique froide. Pour lui, un meurtrier est responsable de ses choix, les faits le prouvent. Cet esprit aussi moderne que rigide, est mis en opposition avec une pensée plus philosophique, qui s’appuie sur la notion de karma. La relation qui se crée entre le policier et son suspect est à ce titre particulièrement intéressante lors de cette première heure. Au-delà du jeu du chat et de la souris, c’est surtout leur besoin d’échanger, et de chercher chez l’autre, ou dans le départ de l’autre, une rédemption qui donne de la richesse à leur rencontre. On comprend rapidement que les deux hommes sont les opposés l’un de l’autre, et en ce sens, se ressemblent beaucoup. [Spoiler] Tout deux ont vu leur vie changer radicalement suite à un événement violent et traumatisant qui a conditionné leur façon de penser et leurs croyances. [/Spoiler] Paradoxalement, c’est le personnage de Takeshi Kaneshiro, à la logique implacable, qui va véritablement illustrer le sens de la philosophie karmique.
L’opposition entre différents styles n’est cependant pas uniquement thématique. Comme on a pu le voir, le combat/reconstitution en est un parfait exemple, mais on peut généraliser ce constat à l’ensemble des affrontements. En effet, si l’utilisation répétée (et non nécessaire) des câbles s’inscrit dans la continuité des chorégraphies d’antan, les protagonistes ne se contente pas d’utiliser le kung fu, et, comme souvent lorsque Donnie Yen est chorégraphe, il s’agit plutôt d’arts martiaux mixés (MMA). Les influences de la star sont moins manifestes que dans des films modernes comme Flash Point, mais les duels bénéficient d’une approche moins traditionnels que les combats qu’a pu chorégraphier Sammo Hung pour Ip Man et Ip Man 2 par exemple. On retrouve également une brève scène de parkour, pratique que Donnie Yen semble apprécier, puisque non seulement il effectue lui-même certaines acrobaties, mais il avait déjà eu l’occasion de s’y essayer dans Bodyguards And Assassins. L’utilisation de la technique de la chemise de fer est aussi teintée de modernité : plus que pour donner de l’attrait à la chorégraphie martiale, elle illustre les thématiques et permet au réalisateur d’inscrire sa scène dans un registre presque horrifique, impression d’ailleurs renforcée par un cadre angoissant.
Un récit intimiste
Le cadre est angoissant car les décors sont peu nombreux, et malgré un nombre de figurants assez conséquent, l’intrigue est centrée sur une cellule presque familiale. L’aspect tranche de vie renforce d’ailleurs cette sensation d’être immergé dans un microcosme, ce qui donne de l’intensité aux événements mais crée également un univers peu étendu, à la limite de la claustrophobie. Le réalisateur joue sur ce sentiment en exploitant notamment l’imagerie effrayante de la forêt, peu étendue, aux arbres ressemblant presque à des barreaux de prison. Mais c’est surtout lors du final, se déroulant dans une maison modeste, qui semble séparée du reste du monde par une pluie torrentielle, que l’on se sent, tout comme les personnages, prisonniers d’un destin tout tracé. A ce titre, le discours sur le karma est très bien illustré, puisque plutôt que de l’expliquer en détails à plusieurs reprises, Peter Chan fait le choix de nous le faire vivre par l’intermédiaire des personnages.
Et c’est bien là la force de ce Wu Xia : rendre le quotidien crédible, à défaut d’être aussi réaliste qu’on l’aurait souhaité, et rendre la vie des protagonistes suffisamment vraie pour que l’on s’y attache et que l’on s’inquiète de leur avenir. La relation entre le héros est son épouse est par exemple particulièrement touchante. Evitant les scènes trop larmoyantes ou grand guignol, le réalisateur nous montre leur complicité à travers des détails qui évoqueront des souvenirs à tous les spectateurs, tant ils sont universels. L’épouse joue d’ailleurs un rôle primordial dans la découverte du caractère de Liu Jinxi. Car bien qu’il soit le héros, ou du moins le protagoniste, il ne nous est montré, dans un premier temps, que de loin. C’est à travers les yeux des autres personnages qu’on apprend à le connaître et qu’on découvre que les zones d’ombres qui l’entourent sont nombreuses et vastes. Et si ses origines n’échapperont à personne, la façon dont elles nous sont dévoilées maintient un suspense appréciable.
Bien sûr, c’est principalement par la narration du policier incarné par Takeshi Kaneshiro que l’on comprend qui peut être ce Liu Jinxi. La relation entre les deux hommes est intéressante, car elle ne ressemble pas vraiment à une amitié comme celle de Mickey et Dumbo dans The Killer. Leurs échanges ressemblent plus à des débats philosophiques sur le sens de la vie et l’importance des règles. Le policier, qui cherche à servir la loi à tout prix, oubliant même son humanité, va interroger sa propre notion de la justice et du bien grâce à cette rencontre. Plus qu’une affaire de meurtres, il s’agit d’une véritable quête de rédemption pour lui. Et il devient rapidement évident que sa présence est une histoire de karma, puisque c’est son histoire personnelle qui va conditionner ses choix, ce qui aura des conséquences sur le destin de tous les autres personnages.
Un manque de cohésion d’ensemble
Wu Xia ne manque donc pas d’éléments intéressants, et au-delà des similitudes avec A History Of Violence, le traitement du récit est intéressant à plus d’un titre. Pourtant, il est difficile de ne pas regretter certains partis pris. On ne peut que se demander si le montage actuel n’a pas été amputé de plusieurs scènes. En effet, il manque une véritable transition entre la première heure et la suivante. Alors que le développement des personnages était primordial, il semble soudainement que Peter Chan ait décidé de faire avancer son récit et traite les protagonistes comme des pions. C’est particulièrement vrai dans le cas des 72 démons, dont les réactions sont intéressantes, mais jamais suffisamment exploitées. On regrettera d’ailleurs que Jimmy Wang Yu apparaisse si peu. Néanmoins, il parvient à transcender un rôle intéressant mais pas suffisamment écrit grâce à un jeu vraiment inspiré, et à une présence surprenante. L’acteur, qui ne s’est jamais montré aussi charismatique ou versatile qu’un Ti Lung, parvient non seulement à être crédible, mais à nous donner envie de le voir davantage. Il est d’ailleurs le seul à tirer son épingle du jeu.
Le reste du casting est peu inspiré, à l’image d’un Donnie Yen dont le jeu monolithique peine vraiment à convaincre. On ne le sent jamais vraiment troublé ou tourmenté, et ses tentatives pour nous émouvoir sont, comme dans Ip Man 2, décevantes. Son attitude calme fonctionne par moments, comme lorsqu’il nous fait comprendre qu’il va passer aux choses sérieuses dans les combats, mais ce n’est pas suffisant. On appréciera par contre le contraste entre son jeu calme et la frénésie du personnage de Takeshi Kaneshiro. Ce dernier interprète un policier troublé, mais pas suffisamment exploité et livre une interprétation correcte mais peu inspirée. Sa narration n’est pas non plus exempte de défauts. On regrettera par exemple qu’il explique en voix off l’événement qui a changé sa vie, alors qu’il le racontera avec exactement les mêmes mots au personnage de Donnie Yen quelques minutes plus tard. Ce choix diminue énormément l’impact de la scène et n’apporte rien à l’intrigue. Il renforce également l’impression que plusieurs scènes ont été coupées, raccourcies, ou remontées, et qu’il a été nécessaire de combler certains manques.
Wu Xia est donc une œuvre intéressante et travaillée, riche thématiquement et visuellement, à la bande originale très réussie, mais qui souffre d’une écriture qui manque de finition et d’un montage peut-être imposé. Néanmoins, l’expérience est audacieuse et intéressante, et il est facile de trouver des scènes qui méritent largement qu’on visionne le film.
Critique de la version de 1h56 en cantonais.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 9/27/2011 - haut |
 |
 |
Magic Crystal (1986) |
 |
 |

 Andy, un séduisant aventurier expert en kung fu (Andy Lau), part aider un ami en Grèce en compagnie de son jeune neveu Pin Pin (Ben Siu Ban Ban ). Traqué par Interpol et le KGB, à cause d’une pierre de jade possédant d’étrange pouvoir, l’ami la cache dans la valise de Pin Pin. Le gamin se lie d’amitié avec la pierre qui s’avère être d’origine extraterrestre et pourvue de nombreux pouvoirs entre autres de télépathie et de contrôle des esprits. Devenu la nouvelle cible de Karov (Richard Norton), chef d’agents du KGB et redoutable combattant martial, Pin Pin et son nouvel ami extraterrestre devront compter, pour leur échapper, sur l’aide d’Andy, accompagné de Cyndi (Cynthia Rothrock), une agent d’Interpol également experte en kung fu. Andy, un séduisant aventurier expert en kung fu (Andy Lau), part aider un ami en Grèce en compagnie de son jeune neveu Pin Pin (Ben Siu Ban Ban ). Traqué par Interpol et le KGB, à cause d’une pierre de jade possédant d’étrange pouvoir, l’ami la cache dans la valise de Pin Pin. Le gamin se lie d’amitié avec la pierre qui s’avère être d’origine extraterrestre et pourvue de nombreux pouvoirs entre autres de télépathie et de contrôle des esprits. Devenu la nouvelle cible de Karov (Richard Norton), chef d’agents du KGB et redoutable combattant martial, Pin Pin et son nouvel ami extraterrestre devront compter, pour leur échapper, sur l’aide d’Andy, accompagné de Cyndi (Cynthia Rothrock), une agent d’Interpol également experte en kung fu.
 Entre septembre 86 et janvier 87 le cinéma de Hong-Kong a produit quatre films d'action à la «Indiana Jones», c'est a dire des récits d'aventures exotiques et rocambolesques tournant la plupart du temps autour de héros intrépides, d'objets sacrés aux pouvoirs surnaturels, et de cavernes antiques remplies de pièges. Armour of God avec Jackie Chan est le plus connu de ces films. Mais il y a également Legend of Wisely et The Seventh Curse adaptation filmique du sérial Wisely, le Bob Morane Chinois. Seventh Curse a été produit et scénarisé par Wong Jing mais ce dernier a également écrit et réalisé The Magic Crystal qui est la première des quatre productions à sortir en salle. Entre septembre 86 et janvier 87 le cinéma de Hong-Kong a produit quatre films d'action à la «Indiana Jones», c'est a dire des récits d'aventures exotiques et rocambolesques tournant la plupart du temps autour de héros intrépides, d'objets sacrés aux pouvoirs surnaturels, et de cavernes antiques remplies de pièges. Armour of God avec Jackie Chan est le plus connu de ces films. Mais il y a également Legend of Wisely et The Seventh Curse adaptation filmique du sérial Wisely, le Bob Morane Chinois. Seventh Curse a été produit et scénarisé par Wong Jing mais ce dernier a également écrit et réalisé The Magic Crystal qui est la première des quatre productions à sortir en salle.
Mettant en vedette Andy Lau, Wong Jing lui-même, de même que les artistes martiaux gweilos Cynthia Rothrock et Richard Norton, Magic Crystal, en plus d'emprunter certains décors et péripéties de Raiders of the Lost Ark / Les Aventuriers de l'arche perdue s'est également approprié la prémice du plus gros blockbuster de Steven Spielberg, rien de moins que E.T., l'Extra Terrestre. Wong a toutefois en grande partie ré-imaginé la trame du petit garçon et son ET pour convenir à la fois aux moyens qu'il avait à sa disposition et au gout du public hongkongais, c'est-à-dire à grand coups de scène d’action, d’humour burlesque et de sentimentalité facile. Il en a résulté que Magic Crystal est un triple exemple à la fois de films de science fiction «made in HK», de film d’action des années 80 et de film ratatouille à la Wong Jing.
Magic Crystal est un point tournant dans la carrière de Wong Jing, presque même un nouveau départ puisque c’était son premier film comme metteur en scène réalisé hors des studios Shaw Brothers chez qui il avait commencé sa carrière derrière la caméra dès 1981. En cinq ans, il réalisa neuf films pour les Studios, des comédies pour la plupart, dont certaines furent les productions Shaw les plus populaires des années 80. Hélas, comme la Shaw étaient à l'époque complètement supplantée par les comédies des rivaux Cinema City et les films d'action de Jackie et Sammo Hung, les films de Wong étaient loin de se retrouver au sommet du box-office. Les Shaw ayant finalement fermé leurs portes en 1985, Wong Jing devient un indépendant et pour sa première production non-Shaw il mit les bouchées doubles avec un film tenant à la fois de ET, de Raiders of the Lost Ark, du sérial Wisely et des comédies d'action à la mode à l'époque. Les studios Golden Harvest et Cinema City. préparant des super-productions de films à la Indiana Jones pour les fêtes du nouvel an chinois de 1987 (avec respectivement Armour of God et Legend of Wisely), Wong en bon opportuniste qu'il était, semble avoir décidé de leur damer le pion en produisant ses propres films d'aventures exotiques (Magic Crystal mais également Seventh Curse qui seraient lancés plusieurs mois avant les productions des gros studios).
Wong a également un peu lorgné du coté de Sammo Hung qui était alors le grand maître d'oeuvre du cinéma d'action made in HK. C'est ainsi qu'il recruta un trio d'acteurs s'étant distingués dans des productions de Sammo Hung : l'experte martiale américaine Cynthia Rothrock (vue dans Yes Madam et Millionaire's Express), le karatéka australien Richard Norton (Twinkle, Twinkle Lucky Stars, Millionaire's Express) et surtout l'acteur et idole canto-pop naissant Andy Lau dont l’athlétisme martial fut révélé dans son petit rôle «guest star» de policier casse-cou dans Twinkle, Twinkle Lucky Stars. Jouant un aventurier gai luron, téméraire et irrévérencieux, son personnage est passablement calqué sur la personnalité filmique d'une autre grande idole canto pop des années 70/80 : Sam Hui vedette de la série des Aces Go Places / Mad Mission et qui était également la vedette de Legend Of Wisely.
Pour jouer le rôle du gamin Wong engagea le jeune Xiao Bin Bin, l'enfant vedette à la fois à Taiwan et à Hong Kong à l'époque. Pour jouer la demoiselle en détresse, obligatoire dans ce genre de film, il fit appel à une nouvelle venue Sharla Cheung Man dont c'était le premier rôle au cinéma (son personnage toutefois n'apparaît que tardivement et disparaîtra bien vite). Pour l'élément comique du film, Wong recruta son pote Nat Chan qui était apparu dans presque tous ses films jusque là et se reservit pour lui-même un rôle de faire valoir comique, type de rôle qu'il reprenait presque toujours dans ses propres films. Pour assurer le cachet exotique du film, une partie du tournage s'est fait en Grèce, certaines scènes se déroulant même sur le site de l'Acropole d’Athènes. Par contre, les scènes dans la grotte truffée de pièges ont été tournées dans un studio de Taiwan.
Même si une créature extra-terrestre est au cœur du récit, la façon dont Wong l'aborde et présente tant ses pouvoirs que sa relation avec le gamin reflète bien le manque d'affinité et l'aptitude technique limitée du cinéma de Hong Kong pour la science fiction. C'est ainsi que les scènes de combat ont au moins trois fois plus de temps à l'écran que le ET. Celui-ci consiste en un simple morceau de plastique vert illuminé pourvu de quelques pièces escamotables (incluant un doigt lumineux). En fait, l'emploi du ET se résume le plus souvent à celui de simple "McGuffin" (l'objet recherché tant par les protagonistes que les antagonistes du film) de même que source de gags loufoques lorsque l'ET utilise ses super-pouvoirs pour jouer des tours pendables aux deux pîtres du film : Wong Jing et surtout Nat Chan qui subissent une série d'avanies aussi fantaisistes que saugrenues. Malgré l'emploi presque marginal de l'ET, l'utilisation de certains effets visuels simples mais efficaces ajoutés au jeu à la fois béat, candide et très expressif du jeune Xiao Ban Ban et la propre voix de la pierre extraterrestre (enfantine dans la version chinoise, de jeune femme dans la version française) compensent quelque peu les lacunes techniques du film et rendent un tant soit peu crédible et sympathique la relation entre l'enfant et l'ET.
Pour diriger les scènes d’action, qui sont l'élément dominant du film, Wong Jing fit appel à celui qui était déjà son chorégraphe habituel depuis déjà quelques films : Tony Leung Siu Hung . Et à la vue de la quantité des affrontements et de leur virtuosité on peut le considérer comme pratiquement le co-réalisateur du film. Cynthia Rothrock et Richard Norton ont de longues scènes de combat robustes, articulées et spectaculaires démontrant amplement leur expertise martiale soit l’un contre l’autre soit contre d’autres adversaires. La démonstration de l'utilisation du sai (poignard) par Norton compte probablement parmi l’une des meilleures jamais vues de tout le cinéma martial. Le talent de Tony Leung Siu Hung à la chorégraphie est également bien mis en évidence par son habilité à transformer Andy Lau en un combattant martial crédible. Il se bat aussi souvent que Rothrock et Norton dans des affrontements tout aussi enlevés. La plupart du temps, il bataille dans le style kickboxer acrobatique typique de l’époque (avec doublure occasionnelle naturellement) bien qu’à de brefs moments il emploie également un parapluie et se met à faire une pose comique à la Charlie Chaplin qui fait sourire. La palme du moment martial le plus surprenant et délicieux doit cependant revenir à la prestation surprise de l’ancienne actrice de la Shaw Bros Wong Mei Mei, mais en dire davantage constituerait un malheureux spoiler.
Bien qu’il soit le héros vedette du film, Andy Lau est loin de prendre toute la place et le scénario laisse presque tous les personnages, même secondaires, faire leur numéro qu’il soit d’action (Andy, Cynthia, Richard Norton), comique (Wong Jing et Nat Chan) ou de science fiction (le gamin et son ET). Même des acteurs au rôle mineur comme Max Mok Siu Chung, Sek Kin, Shum Wai, et Shing Fui On, ce dernier dans une apparition éclair, ont leurs petits moments. Les numéros comiques sont assez inégaux, la palme des plus balourds appartenant à ceux centrés sur le personnage de l’assistant ahuri et gaffeur joué par Wong Jing. À un moment donné, on le retrouve même à faire des piteries dans les toilettes. En comparaison, les numéros comiques de Nat Chan paraissent presque sophistiqués.
Toutefois, certains des moments les plus savoureusement amusants du film se retrouvent là où l'on s'y attend le moins : dans les réparties sardoniques du grand méchant joué par Richard Norton. Déjà dans les films de Sammo Hung où il est d’abord apparu, il s'était prouvé autant adepte à la replique assassine (« C'est douloureux ? ») qu'aux coups de poing. Maintenant qu'il est le méchant en chef, il a droit à des dialogues entiers jouant sur la cruauté suave et un humour des plus narquois. Loin des personnages de brutes caricaturales au jeu grossier qui est le lot habituel des acteurs gweilos, Norton a toujours su démontrer une certaine aisance et expertise tant comique que corporelle qui sied bien au cinéma hongkongais et ceci lui a permis de donner à ses méchants une indéniable distinction. Des années plus tard Wong Jing s’en souviendra et il réutilisera Norton pour un autre rôle de grand méchant dans City Hunter.
Sorti le 17 septembre 1986, soit cinq mois avant les films à la « Indiana Jones » du nouvel an, Magic Crystal se classa 18ème au box-office local soit à peu près la même position que la plupart des comédies Shaw de Wong Jing. Malgré le calibre relevé de ses scènes de combats, Magic Crystal n'est que marginallement reconnu parmi les fans occidentaux du cinéma hongkongais. Le film est plutôt considéré comme un ovni filmique, de par sa trame et ses effets spéciaux bien sûr mais également pour sa réputation inégale. En effet, certaines critiques le réduisent bien souvent à un médiocre nanar dont les scènes d’action sont le seul élément de qualité. C’est un peu sommaire comme évaluation bien que compréhensible de la part de quiconque n’a pas grand goût pour l’humour potache « made in HK».
Certes, le film est inégal avec son burlesque le plus souvent balourd et son scénario peu abouti (lacunes typiques chez Wong Jing) mais au delà de ces scènes de combat qui sont en effet son atout principal, on pourrait dire que Magic Crystal bénéficie également d’une certaine exubérance communicative, d'un rythme entraînant, du charisme potable de ses acteurs et d’un certain lustre visuel amené tant par le tournage en Grèce que par la qualité de la direction artistique qui ressort surtout lors de la séquence dans la grotte piégée où se dénoue le film. Le manque de prétention du film, sa truculence ajoutée à l’emploi d’effet spéciaux modestes mais efficaces la plupart du temps en font un bon exemple de cinéma bis un brin niais mais ingénieux et sympathique alors que les combats tourbillonnants en font également un excellent exemple d'un film d'action made in HK des années 80. Au final, pour ceux qui savent appréhender le cinéma « wongjinien » et son humour Magic Crystal peut s'avérer un fort bon divertissement.
NB : En 2008, Steven Spielberg réalisa Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Or dans ces nouvelles aventures du téméraire archéologue celui-ci est confronté à des méchants russes pour la possession d’un crane en cristal d’origine extra-terrestre qui est éventuellement ramené à son lieu d’origine : une soucoupe volante enterrée dans une caverne ancienne remplie de pièges. Est-ce que la trame parait familière? Même le sort du méchant russe en chef dans Kingdom rappelle le sort de celui apparaissant dans Magic Crystal. De Spielberg à Wong Jing puis de Wong Jing à Spielberg, la boucle est bouclée. Plus recemment en 2011, Wong Jing produisit et co-réalisa, Treasure Hunt, un autre film d'aventures exotique avec un personnage de gamin (joué par Lucas Tse fils de Cecilia Cheung et Nicholas Tse ) qui d'un premier coup d'oeil est une copie conforme du gamin joué par Xiao Bin Bin vingt-cinq ans plus tôt (le nom du fils de ce dernier Little Xiao Xiao Bin, a été a un moment lié à la production de ce film). Comme dans Magic Crystal jadis, Wong Jing apparaît encore une fois dans un rôle de faire valoir comique.
|
 |
 |
Yves Gendron 9/18/2011 - haut |
 |
 |
Overheard 2 (2011) |
 |
 |

 Un homme d'affaires (Lau Ching Wan) découvre au cours d'un accident de voiture qu'il a été mis sur écoute. L'inspecteur chargé de l'enquête (Louis Koo) découvre lui, que l'auteur de ces écoutes est Joe (Daniel Wu). Mais qui manipule qui en réalité ? Un jeu de mensonges-vérités se dévoile... Un homme d'affaires (Lau Ching Wan) découvre au cours d'un accident de voiture qu'il a été mis sur écoute. L'inspecteur chargé de l'enquête (Louis Koo) découvre lui, que l'auteur de ces écoutes est Joe (Daniel Wu). Mais qui manipule qui en réalité ? Un jeu de mensonges-vérités se dévoile...
 Après le brillant Overheard de 2009, réalisé par le duo Alan Mak – Felix Chong, il était tentant d’offrir une suite à ce concept musclé qui mélangeait habillement suspense et action autour de manigances financières. Toutefois, sans rien dévoiler du premier film, il était difficile d’envisager une continuité cohérente aux vies chahutées des trois personnages principaux ; or la distribution du numéro deux repose sur le même trio qui a fait en grande partie le succès du premier (Louis Koo, Lau Ching Wan et Daniel Wu). La surprise ne peut qu’être au rendez-vous, car ce n’est tout simplement ni une suite, ni une préquelle ou quoi que ce soit du genre. Ce Overheard n’a de deuxième que le nom. Le casting et l’équipe technique sont similaires, mais l’histoire ne reprend en rien la trame laissée en 2009. Après le brillant Overheard de 2009, réalisé par le duo Alan Mak – Felix Chong, il était tentant d’offrir une suite à ce concept musclé qui mélangeait habillement suspense et action autour de manigances financières. Toutefois, sans rien dévoiler du premier film, il était difficile d’envisager une continuité cohérente aux vies chahutées des trois personnages principaux ; or la distribution du numéro deux repose sur le même trio qui a fait en grande partie le succès du premier (Louis Koo, Lau Ching Wan et Daniel Wu). La surprise ne peut qu’être au rendez-vous, car ce n’est tout simplement ni une suite, ni une préquelle ou quoi que ce soit du genre. Ce Overheard n’a de deuxième que le nom. Le casting et l’équipe technique sont similaires, mais l’histoire ne reprend en rien la trame laissée en 2009.
Le premier opus avait pour cadre une équipe de spécialistes des écoutes téléphoniques et de la vidéosurveillance dans une brigade de répression des fraudes financières, d’où le titre. Sous couvert de garder cette combinaison espionnage/finance,Overheard 2 part sur une intrigue différente mais tout aussi alambiquée que le premier film. Il s’agit bel et bien d’un imbroglio financier, sur fond de vengeance et de manipulation, mais cette fois Louis Koo est un inspecteur solitaire qui traque un talentueux trader (Lau Ching Wan) lui-même menacé par un jeune truand aux motivations équivoques (Daniel Wu). D’équipiers soudés et solidaires, les trois acteurs deviennent ennemis dans une triangulaire torturée, et livrent au passage des prestations de très bonne qualité.
Passé la surprise de ne pas retrouver les attachants Johnny, Gene et Max, que penser de ce Overheard 2 ? Le sentiment est ambivalent mais au final, c’est très largement un sentiment positif qui l’emporte. Le film est acide et en ce sens savoureux. Démonstration est faite par quelques personnages, chantres de la finance et du capitalisme à tous crins, que sans eux la société ne fonctionnerait pas. Le déroulement de l’histoire montre pourtant un monde sans scrupule où fort peu de place est laissée au facteur humain et au développement de l’entreprise. Tout comme dans le premier opus, ce double discours ne peut passer inaperçu dans la société hongkongaise, où l’argent est un culte et la finance une culture de masse.
A cette toile de fond s’ajoutent des chausse-trappes narratifs, qui se posent et se défont tandis que d’autres se referment de manière inattendue. C’est bien dosé, relativement équilibré et dans ces univers de défiance, les victimes ne sont pas toujours celles qu’on croit. D’ailleurs, la dernière intrigue financière livrée par Hollywood, Wall Street 2, peut bien aller se rhabiller. Overheard 2 est beaucoup plus noir, plus féroce… sans concession.
Certes, le rythme manque dans la première heure ; les deux réalisateurs s’emmêlent quelque peu dans une installation fastidieuse qui a cependant le mérite de poser des personnages ambigus, et des effets de style un peu trop maniérés. Toujours en comparaison avec le premier du nom, Overheard 2 est plus nerveux mais aussi plus précieux –voir prétentieux- sur la forme. A ce titre, la séquence d’ouverture est longue et sert de véritable démonstration de savoir-faire.
Le film est volontairement plus froid et austère que son prédécesseur. Le contexte est plus dur et Overheard 2 en est le reflet. Le trio d’acteurs prend davantage de distance, l’empathie avec les personnages est réduite et la direction de la photographie pousse en ce sens avec une image bleutée et glacée. Plus question de camaraderie pour trouver de l’aide, Alan Mak et Felix Chong écrasent leurs personnages dans des paysages urbains tristes et rêches.
Est-il utile d’insister sur ce bémol ? Mais après tout oui, il faut exorciser ce vilain travers devenu mode pour flatter un certain public. Même ici, au cœur d’un polar d’excellente facture, quelques personnages se laissent aller au couplet légèrement nationalo-xénophobe de plus en plus récurrent. Il faut s’unir contre « l’étranger », il faut se méfier de « l’investisseur étranger ». Pommade de convenance pour les uns, urticant de plus en plus régulier pour les autres. Voilà c’est dit.
Il n’en reste pas moins qu’Overheard 2 est un très bon thriller made in Hong Kong, qui bénéficie d’une agréable montée en puissance et de beaucoup de surprises. L’équipe gagnante du premier a donc réussi son pari de renouer avec le succès tout en bouleversant la formule. C’est la recette d’une bonne franchise. A quand Overheard 3 sur le même concept ?
|
 |
 |
François Drémeaux 9/1/2011 - haut |
 |
 |
Mortal Kombat (1995) |
 |
 |
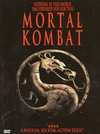
 Liu Kang, un jeune Chinois expert en arts martiaux, apprend que son jeune frère a été tué par le maléfique sorcier Shang Tsung. Ce dernier projette d’envahir la Terre mais pour ce faire il doit remporter un tournoi millénaire du nom de Mortal Kombat. Pour l’empêcher d’arriver à ses fins Rayden, le Dieu des éclairs et du tonnerre, fait appel à trois humains : Liu Kang, Johnny Cage, un acteur de cinéma d’action et Sonya Blade, des forces spéciales. Liu Kang, un jeune Chinois expert en arts martiaux, apprend que son jeune frère a été tué par le maléfique sorcier Shang Tsung. Ce dernier projette d’envahir la Terre mais pour ce faire il doit remporter un tournoi millénaire du nom de Mortal Kombat. Pour l’empêcher d’arriver à ses fins Rayden, le Dieu des éclairs et du tonnerre, fait appel à trois humains : Liu Kang, Johnny Cage, un acteur de cinéma d’action et Sonya Blade, des forces spéciales.
 En 1991, Capcom lâche une véritable bombe dans les salles d’arcade avec le désormais mythique "Street Fighter 2". Ce jeu de versus fighting devient un hit planétaire et voit donc en toute logique une horde de clones débarquer chez la concurrence. L’un d’eux parvient à se démarquer par son style graphique réaliste et son ultra violence. Son nom : Mortal Kombat. Énorme succès aux États-Unis, Hollywood ne tarde pas à acheter les droits pour en faire un film. Les adaptations vidéoludiques sont vaguement à la mode à cette époque et l’année précédente un certain Street Fighter avec l’inénarrable Jean-Claude Van Damme rencontre un fort joli succès dans les salles obscures. En 1991, Capcom lâche une véritable bombe dans les salles d’arcade avec le désormais mythique "Street Fighter 2". Ce jeu de versus fighting devient un hit planétaire et voit donc en toute logique une horde de clones débarquer chez la concurrence. L’un d’eux parvient à se démarquer par son style graphique réaliste et son ultra violence. Son nom : Mortal Kombat. Énorme succès aux États-Unis, Hollywood ne tarde pas à acheter les droits pour en faire un film. Les adaptations vidéoludiques sont vaguement à la mode à cette époque et l’année précédente un certain Street Fighter avec l’inénarrable Jean-Claude Van Damme rencontre un fort joli succès dans les salles obscures.
En premier lieu, il est intéressant de noter que contrairement aux autres adaptations de l’époque, le film Mortal Kombat est très fidèle au jeu-vidéo dont il est tiré. Le scénario est le même, les décors respectent bien l’univers développé dans les jeux, idem pour les costumes. On appréciera également le casting particulièrement judicieux car la plupart des acteurs ressemble beaucoup aux personnages qu’ils interprètent. Finalement, le seul point noir au niveau de l’adaptation c’est de voir que le film est expurgé de toute la violence et de l’hémoglobine qui coule pourtant à flots dans la saga vidéoludique. Décision purement commerciale mais qui peut se comprendre même si on ne l’approuve pas. Le jeu vidéo étant à l’époque considéré comme un loisir pour les gosses, respecter la violence du jeu aurait donc eu pour conséquence de se priver d’une partie du public visé. Néanmoins, Mortal Kombat le film reste une adaptation de qualité. Le réalisateur, Paul Anderson, ne fera pourtant pas preuve du même respect lorsqu’il transposera quelques années plus tard une autre saga culte créée par Capcom, Resident Evil.
Cependant, ici la réalisation ne fera pas date dans l’histoire du cinéma d’arts martiaux. Le film est mis en scène avec une certaine application mais ne se démarque en rien de n’importe quel film hollywoodien du même genre. Les scènes de combats sont en effet très typiques de ce que pouvait nous proposer le cinéma américain à cette époque. Peu de plans larges, des enchaînements souvent très courts, une action très découpée avec de nombreux gros plans, en particulier lors des impacts, pour des affrontements qui ne sont au final jamais bien longs. A la décharge du metteur en scène, des acteurs principaux seul Robin Shou est un véritable pratiquant en arts martiaux. Toutefois, si les combats sont filmés sans grand talent ils n’en restent pas moins assez lisibles et ils ont le mérite de faire preuve d’une certaine variété. De plus, les personnages utilisent de nombreux coups spéciaux issus des jeux, ce qui est fort appréciable.
Le scénario quant à lui est médiocre mais reste tout de même fidèle au jeu. L’histoire n’a rien de bien originale mais néanmoins on sent qu’un effort est fait pour mettre en place toute une mythologie appelée à se développer par la suite. Ce qui pose problème en revanche, c’est la façon dont se déroule le tournoi. Oubliez l’idée d’un tirage au sort et d’un tableau de qualifications comme on pourrait en avoir dans n’importe quelle compétition. Ici, c’est étrangement le sorcier Shang Tsung qui semble décider comme bon lui semble du déroulement du tournoi. N’importe qui peut décider d’affronter le maléfique Goro s’il le souhaite. Du coup, Johnny Cage se retrouve en « finale » en ayant combattu qu’une fois tandis que son compagnon Liu Kang a déjà affronté trois adversaires différents. Apparemment, il existe aussi un règlement très pointilleux mais pas toujours respecté. On peut le contourner aisément comme le prouve la dernière partie du long-métrage.
Passons outre ce manque de cohérence et intéressons-nous aux acteurs. Si leurs prestations ne resteront pas dans les annales, on appréciera néanmoins que le trio formé par Robin Shou, Linden Ashby et Bridgette Wilson fonctionne bien. Leurs relations paraissant du coup assez crédibles. Plutôt charismatique dans son rôle de sorcier maléfique, Cary-Hiroyuki Tagawa fronce un peu trop les sourcils pour être totalement convaincant. Et comment parler des acteurs sans évoquer le cas Christophe Lambert ? Oubliez donc Greystoke, il nous livre ici une composition mémorable qu’on ne peut simplement pas décrire avec de simples mots. On rappellera juste qu’il joue le rôle d’un Dieu et là tout est dit.
Au final, Mortal Kombat est le prototype même de film qui ne peut s’apprécier qu’en connaissant l’œuvre dont il est tiré car le long-métrage n’a pas d’autre but que de satisfaire le fan. Ainsi, si l’on connaît et apprécie le jeu "Mortal Kombat", on regardera le film avec un certain plaisir. Quant aux autres, ils resteront totalement hermétiques à cet univers qu’ils ne connaissent pas. Ce n’est pas la réalisation quelconque et les grosses faiblesses scénaristiques qui leur permettront de s’y intéresser de plus près.
|
 |
 |
Jean-François Gendron 8/13/2011 - haut |
 |
 |
King Of Fighters (2010) |
 |
 |

 Depuis des siècles, les meilleurs combattants issus de clans légendaires, s'affrontent au tournoi du King of Fighters. Pour eux, seuls comptent l'honneur et la victoire. Mais lorsque le plus puissant de tous, Rugal, décide de ne plus respecter les règles, c'est le monde qui est en danger. Depuis des siècles, les meilleurs combattants issus de clans légendaires, s'affrontent au tournoi du King of Fighters. Pour eux, seuls comptent l'honneur et la victoire. Mais lorsque le plus puissant de tous, Rugal, décide de ne plus respecter les règles, c'est le monde qui est en danger.
 Dans l’histoire des adaptations de jeux vidéo en film, on ne peut pas vraiment dire que les réussites soient particulièrement nombreuses. Il y a bien le très bon, mais très imparfait, Silent Hill de Christophe Gans, le sympathique film de série B Mortal Kombat avec notre Christophe Lambert national, ou le totalement décomplexé et plutôt fun Dead Or Alive. Mais ce ne sont là que des exceptions qui confirment la règle qui veut que les adaptations vidéoludiques soient à chaque fois ratées. Comme le prouve des « œuvres » proches du nanar telles que les deux Street Fighter, Mortal Kombat Destruction Finale, Double Dragon ou bien encore Super Mario Bros. The King Of Fighters fait-il partie de ces exceptions ? Dans l’histoire des adaptations de jeux vidéo en film, on ne peut pas vraiment dire que les réussites soient particulièrement nombreuses. Il y a bien le très bon, mais très imparfait, Silent Hill de Christophe Gans, le sympathique film de série B Mortal Kombat avec notre Christophe Lambert national, ou le totalement décomplexé et plutôt fun Dead Or Alive. Mais ce ne sont là que des exceptions qui confirment la règle qui veut que les adaptations vidéoludiques soient à chaque fois ratées. Comme le prouve des « œuvres » proches du nanar telles que les deux Street Fighter, Mortal Kombat Destruction Finale, Double Dragon ou bien encore Super Mario Bros. The King Of Fighters fait-il partie de ces exceptions ?
Dans un premier temps, on remarque vite que le film n’a strictement rien à voir avec la célèbre série de jeux vidéo de baston créée par SNK. Le problème c’est qu’il y a pas vraiment de scénario dans le jeu donc il faut bien en broder un pour le film. Là, on nous rajoute un monde parallèle auquel on accède avec des sortes d’oreillettes Bluetooth, et une histoire de reliques ancestrales dont on se désintéresse totalement. Les personnages n’ont strictement rien à voir avec ceux du jeu. Terry Bogard est un agent du FBI, Mai Shiranui une flic infiltrée, Kyo se bat avec un sabre (euh, ici on est censé être dans King Of Fighters pas Samouraï Showdown) et ne ressemble même pas à un Japonais. Les acteurs sont tous plus mauvais les uns que les autres. La palme revenant certainement à Ray Park (Darth Maul dans Star Wars) dans son rôle de Rugal où il est absolument pathétique. Une prestation qui n’est pas sans rappeler la médiocrité du personnage de Piccolo interprété par James Marsters dans DragonBall Evolution, une autre adaptation pitoyable.
Le réalisateur de ce film, Gordon Chan, a beau avoir mis en scène un classique du cinéma martial avec Fist Of Legend, sa carrière ne comporte pas que des chefs d’œuvre. Loin de là ! Mais avec The King Of Fighters il atteint des sommets de médiocrité. Les scènes de dialogue sont d’une platitude à faire dormir un insomniaque. Quant aux scènes de combats, elles sont complètement bancales à l’image de la caméra qui était visiblement trop lourde à porter pour le cadreur puisque l’image est constamment de travers. Quelques « magnifiques » effets numériques sont là pour visiblement renforcer l’impact des coups. Effets inutiles puisque moches et ne renforçant rien du tout si ce n’est la laideur du long métrage et ses décors complètements cheaps, en particulier ceux du monde parallèle.
A part les fans de Maggie Q, ou ceux qui se demandaient ce qu’était devenue Françoise Yip (Rumble In The Bronx), je ne vois vraiment pas qui peut trouver son compte devant ce monument de médiocrité aussi catastrophique que le récent Street Fighter : The Legend Of Chun-Li. La seule catégorie dans laquelle The King Of Fighters peut concourir n’est certainement pas celui du roi des combattants mais bien celui du roi de l’adaptation vidéoludique foireuse. Même si la concurrence est rude dans ce domaine. Et prions tous ensemble pour qu’un film tiré de Virtua Fighter ne voie jamais le jour !
|
 |
 |
Jean-François Gendron 8/12/2011 - haut |
 |
 |
Ip Man 2 (2010) |
 |
 |

 Selon Raymond Wong (黄百鸣) le producteur et Wilson Yip (叶伟信) le réalisateur, l'opus 2 racontera l'arrivée du maître à Hong Kong en 1949. Ip Man (Donnie Yen /甄子丹) découvre une ville en désordre, où règnent la misère et la violence. A cette époque, il y avait à HK de nombreuses écoles d'arts martiaux qui se rivalisaient. Beaucoup étaient des émanations des triades qui s'en servaient pour recruter de nouveaux membres, entre autres. Ip Man, révolté par cette situation, va créer sa propre école en rétablissant les règles du wushu. Aussitôt, il est défié... Selon Raymond Wong (黄百鸣) le producteur et Wilson Yip (叶伟信) le réalisateur, l'opus 2 racontera l'arrivée du maître à Hong Kong en 1949. Ip Man (Donnie Yen /甄子丹) découvre une ville en désordre, où règnent la misère et la violence. A cette époque, il y avait à HK de nombreuses écoles d'arts martiaux qui se rivalisaient. Beaucoup étaient des émanations des triades qui s'en servaient pour recruter de nouveaux membres, entre autres. Ip Man, révolté par cette situation, va créer sa propre école en rétablissant les règles du wushu. Aussitôt, il est défié...
 C’est dans les vieux pots… C’est dans les vieux pots…
Si le cinéma de Hong Kong s’est illustré par vagues c’est parce que dans l’ex-colonie britannique, lorsqu’une recette fonctionne, on l’exploite jusqu’à ce que le public manifeste une certaine lassitude. Cet effet de mode s’est exprimé dans l’exploitation de genres, qu’il s’agisse du Wu Xia Pian, de la Kung Fu Comedy, ou encore du polar, mais aussi dans l’utilisation de personnages. Outre la surexposition de certaines stars qui monopolisent l’écran à longueur d’années, c’est aussi la mise en scène de personnages historiques jusqu’à l’excès qui définit une partie du cinéma de Hong Kong. Et si le champion de cet exercice reste certainement le médecin expert en arts martiaux Wong Fei-hong, avec plus d’une centaine de films dédiés à ses exploits, d’autres héros chinois ont peuplé les rêves des spectateurs dans des divertissements aussi spectaculaires que romancés. Car le but de ces œuvres n’est pas de s’inscrire dans une recherche historique crédible, mais de mettre en scène des exploits parfois surréalistes et en tout cas souvent exagérés. Dernièrement, c’est l’expert en Wing Chun, Ip Man qui est devenu la coqueluche des metteurs en scène et des chorégraphes de Hong Kong. Si Wong Kar Wai a annoncé depuis des années son projet de permettre à Tony Leung Chiu Wai d’interpréter le maître dans une biopic, c’est finalement le duo Wilson Yip/Donnie Yen, inauguré dans SPL qui a ouvert la voie avec un premier film tout simplement appelé Ip Man. Bien que les précédentes collaborations des deux hommes aient été l’occasion d’offrir au public des joutes martiales spectaculaires, il s’agissait de leur première incursion ensemble dans le Kung Fu Pian traditionnel. Le succès rencontré a non seulement permis à Herman Yau de profiter de l’engouement pour le personnage en réalisant une préquelle avec Legend Is Born - Ip Man, mais il fut aussi et surtout l’occasion pour Wilson Yip de mettre en chantier une suite.
A la force des poings
Si le public a répondu positivement à Ip Man, c’est pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en ces temps où les wu xia pian dominent largement l’industrie cinématographique, l’arrivée d’un nouveau Kung Fu Pian aux chorégraphies moins fantaisistes, sans être une nouveauté, souffle comme un vent de fraicheur. Ce sentiment est également dû à la mise en valeur du wing chun, style de combat moins varié que d’autres formes plus anciennes de kung-fu, mais à l’impact visuel évident. Si cette technique a peu été exploitée au cinéma, les quelques tentatives pour l’illustrer ont donné des résultats reconnus aujourd’hui encore comme de grandes réussites. Sammo Hung s’en est fait l’un des portes paroles à la fin des années 70, en mettant en scène les exploits du maître Leung Chan dans Warriors Two, mais aussi et surtout dans ce qui reste l’un de ses films les plus appréciés, Prodigal Son. S’il existe d’autres d’exemples, antérieurs et postérieurs à ces deux œuvres, l’implication de Sammo Hung dans des combats basés sur le wing chun s’impose comme un gage de qualité. Il n’était donc pas surprenant que l’équipe s’attache ses services de chorégraphes pour mettre en valeur le wing chun de Ip Man. Les combats du premier épisode ayant convaincu le public, son retour derrière la caméra pour cette suite était assuré. Et le moins qu’on puisse dire est que son investissement a été important puisque Ip Man 2 est composé de pas moins de sept combats, dont quatre particulièrement longs et spectaculaires. Le wing chun est un style basé principalement sur le combat rapproché, en particulier les techniques de poing et les saisies. Les pratiquants évitent généralement les figures acrobatiques et la démonstration pure pour privilégier l’efficacité et la mise hors d’état de nuire rapide. Pourtant, la propension devenue excessive des équipes de Hong Kong à employer des câbles là où il n’y en aurait jamais eu quinze ans plus tôt a privé le premier Ip Man du réalisme pourtant nécessaire pour réellement s’immerger dans les affrontements. Pour cette suite, Sammo Hung a fait le choix de conserver une approche identique, utilisant une fois de plus les trucages pour rehausser les mouvements de certains acteurs dont l’âge a diminué l’agilité, ou encore pour atténuer la dangerosité de certaines chutes. Mais cet emploi reste inférieur si on excepte le fameux duel sur une table. Car l’une des forces de ce second opus est de varier les situations et les capacités des différents protagonistes, donnant lieu à des affrontements très différents.
Des combats d’anthologie
Si le wing chun reste la principale attraction, c’est en effet sa confrontation avec d’autres styles qui permet à Ip Man 2 de s’illustrer. Les premiers combats sont de facture plutôt classique, et permettent réellement de mettre en valeur la spécificité du wing chun. Donnie Yen s’y montre comme d’habitude, très impressionnant, grâce à la rapidité et surtout à la précision de ses mouvements. Il se montre très convaincant en maître de wing chun, grâce à une assurance qui s’exprime autant dans ses coups que dans sa tenue et son attitude. Mais certaines œuvres antérieures de la star l’ont prouvé, un festival d’action n’est convaincant que si les enjeux dramatiques sont immersifs. Ce qui n’est possible que si les opposants du héros sont suffisamment puissants pour représenter une menace réelle. Et quelle meilleure solution pour rendre un antagoniste imposant que d’employer un acteur dont le bagage martial est réel ? Ainsi, Sammo Hung ne se contente pas, cette fois d’œuvrer derrière la caméra. Il vient également nous gratifier de sa présence devant, dans le rôle d’un maître ancré dans la tradition et particulièrement rigide. L’acteur avait déjà eu l’occasion d’échanger des coups de poing avec Donnie Yen dans SPL, mais c’était son cadet qui occupait alors le poste de chorégraphe. Cette fois, c’est lui qui met en scène le duel, dans un style plus classique, parti pris nécessaire puisqu’il s’agit d’un Kung Fu Pian dont le but est justement de promouvoir une approche plus classique des arts martiaux. Ainsi, la fameuse scène du duel dans un restaurant s’impose comme l’épine dorsal de Ip Man 2, tant du point de vue dramatique qu’en termes de démonstration martiale. C’est également l’occasion de voir en action d’anciennes gloires du cinéma de kung fu, l’ancien Venom Lo Meng, et l’adversaire ultime de la Kung Fu Comedy, Fung Hak On. Celui qui s’est fait connaître comme le crapaud dans Five Venoms est malheureusement mal exploité. En le présentant comme une sorte d’acrobate, l’équipe impose immanquablement l’utilisation de doublures, puisqu’outre l’âge, Lo Meng n’a jamais brillé par ses capacités à bondir dans tous les sens, contrairement aux autres Venoms. Sa technique très particulière basée principalement sur les poings n’est pas non plus mise en valeur par un montage trop découpé qui privilégie les gros plans. Fung Hak On bénéficie d’un traitement plus appréciable, qui permet d’apprécier son agilité et sa vitesse encore bien réelles, même s’il lui est nécessaire d’avoir recours aux câbles pour certains mouvements.
Mais ces deux combats ne constituent que l’apéritif avant le face à face que tout le monde attend. Dès que Sammo Hung bondit devant Donnie Yen, on comprend que cette « revanche » sera au moins aussi marquante que leurs affrontements dans Sha Po Lang. Le contexte, imposant aux adversaires de rester sur la table, sous peine de concéder la victoire, permet de privilégier le combat rapproché, ce qui rend le physique de Sammo Hung plus imposant, et plus inquiétant encore. Les deux acteurs rivalisent de puissance dans des échanges longs et bien plus complexes que tout ce à quoi on a assisté auparavant. L’utilisation répétée de plans américains permet d’ailleurs d’apprécier leurs postures dans leur ensemble, et plusieurs plans sont composés d’une bonne dizaine de figures, ce qui est plus qu’appréciable de nos jours. La chorégraphie met autant en valeur le wing chun que la boxe Hung, donnant l’impression que les adversaires sont aussi puissants l’un que l’autre. Outre le rendu visuel extrêmement spectaculaire de l’affrontement, c’est la sensation qu’Ip Man n’est pas invincible, et que son adversaire représente une véritable menace qui rend le duel si puissant. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’un combat aussi réussi soit présenté dès le deuxième acte du film, et on a bien du mal à imaginer comment le final pourra rivaliser avec une telle démonstration.
La réponse est à la fois convaincante et dérangeante. Du point de vue chorégraphique, la présence d’un boxeur anglais interprété par Darren Shahlavi offre de nouvelles perspectives que n’aurait par permis l’utilisation d’autres styles de kung-fu. Cette dernière partie marque ainsi une véritable rupture avec les combats précédents et oblige Sammo Hung à se dépasser pour ne pas lasser le spectateur. Les deux derniers combats sont en effet relativement similaires, puisqu’il s’agit à chaque fois de l’opposition entre boxe anglaise et kung-fu. C’est ainsi l’occasion de constater que le chorégraphe parvient avec aisance à mettre en relief la singularité de chaque combattant, car malgré certaines figures identiques, chaque duel est unique. Sammo Hung en profite d’ailleurs pour nous rappeler que sa carrure ne l’a jamais empêché de se mouvoir avec beaucoup d’agilité, tout en lui permettant d’être réellement imposant. Son combat contre le boxeur est brutal et violent, sans pour autant sacrifier la complexité de la chorégraphie. Cette rencontre rappelle dans une certaine mesure certains affrontements du Born To Defend de Jet Li, tout en conservant une identité réelle. En comparaison, le coup d’éclat de Ip Man, tout en bénéficiant d’échanges extrêmement inventifs, reste moins marquant, tant chorégraphiquement que thématiquement.
Une force peut devenir une faiblesse
En 2010, on est en droit d’attendre d’un film qu’il s’appuie sur un scénario solide et bien écrit à défaut d’être inventif. Bien sûr, certains films de kung fu plus anciens bénéficiaient d’histoires très réussies, comme Prodigal Son, dont les personnages étaient bien plus intéressants que la moyenne de l’époque. Mais l’intrigue a longtemps été reléguée au second plan dans les fictions d’action de Hong Kong des années 80 et des décennies suivantes. Seulement la production cinématographique mondiale a fortement évolué et les spectateurs de séries B attendent dorénavant plus qu’une succession de scènes d’action. Et si le premier Ip Man présentait une intrigue simple, le côté tranche de vie était intéressant et permettait de suivre les péripéties du héros avec intérêt. Cet opus suit un schéma relativement proche, pour ne pas dire identique. La première heure est ainsi très réussie car elle évite la recherche du spectaculaire pour nous immerger dans le quotidien d’après-guerre. Ce parti pris presque intimiste est plutôt crédible, grâce à un travail minutieux sur la reconstitution et des décors convaincants. Les acteurs s’investissent également beaucoup, même si les talents dramatiques de Donnie Yen atteignent rapidement leurs limites, notamment lorsqu’il essaie de pleurer. L’antagonisme entre son personnage et celui de Sammo Hung est également d’une trivialité qui lui donne beaucoup de crédibilité. Mais c’est finalement la relation qui se noue entre Ip Man et son premier disciple, incarné par Huang Xiao Ming qui reste la plus touchante. En effet, le jeune acteur manifeste un charisme évident et démontre une aisance à véhiculer différentes émotions qui en font un artiste tout à fait prometteur. L’alchimie entre lui et Donnie Yen est également bien réelle et permet de donner beaucoup de force aux liens qui les unissent. Pourtant, dès cette première partie, certains éléments semblent superflus. On sent bien que le retour de Fan Siu Wong et Simon Yam ne sont destinés qu’à faire un clin d’œil appuyé aux spectateurs. Bien sûr, on pourra argumenter que leur présence permet de montrer les difficultés d’après guerre, mais leur apport dans l’intrigue est en vérité insignifiant.
Mais si le scénario de Ip Man 2 est une déception, c’est principalement à cause de son troisième acte. Dès l’arrivée des ignobles occidentaux sans foi ni loi, le récit verse dans la caricature, opposant le fier esprit chinois à l’ignominie occidentale. Le jeu des Gweilos est d’ailleurs aussi risible que les prestations les plus ratées des actionners des années 90. La présence du boxeur anglais, si elle est intéressante du point de vue chorégraphique, donne lieu à des scènes totalement déplacées, dans lequel le racisme et l’ignorance occidentaux sont montrés avec une complaisance proche de la xénophobie. Il suffit de voir ces plans sur le public occidental riant aux éclats d’un Ip Man ne connaissant pas les règles de la boxe. Wilson Yip perd toute mesure et cherche à tout prix à démontrer à quel point les fiers chinois ont du mérite face aux atroces occidentaux, discours totalement manichéen bien difficile à accepter de nos jours. Les élans patriotiques exacerbés existaient déjà dans le premier opus, face à l’envahisseur japonais, mais on sent cette fois une réelle rancœur dans ce traitement. D’ailleurs, comme dans le premier épisode, même le collaborateur de service finira par retrouver son esprit de patriote en se rappelant que l’envahisseur est ignoble et mérite le mépris. Ce traitement est d’autant plus regrettable qu’il atténue l’impact de certaines scènes. Le dernier combat de Sammo Hung répond ainsi thématiquement aux accusations de Ip Man et symbolisent la rédemption du personnage, tout en illustrant le chant du cygne d’une génération qui n’a pas su évoluer en restant trop ancrée dans une tradition trop rigide. Mais ce discours sonne vraiment faux au milieu de la démonstration xénophobe qu’est ce dernier acte.
Malheureusement, c’est bien souvent la dernière partie qui forge l’opinion que l’on a d’un film, et cette conclusion n’est pas la culmination des enjeux dramatiques développés dès l’introduction que l’on était en droit d’attendre. En tant que suite, Ip Man 2 est presque une copie du premier opus, aux qualités évidentes. Les combats sont réellement impressionnants, tout comme la reconstitution. Mais le scénario, qui réserve quelques scènes intéressantes et un parti pris de base convaincant, s’enlise dans des élans patriotiques à la limite de la xénophobie regrettables. En tant que divertissement pur, Ip Man 2 convaincra les fans, mais sa dernière partie risque de diviser.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 8/6/2011 - haut |
 |
|

|